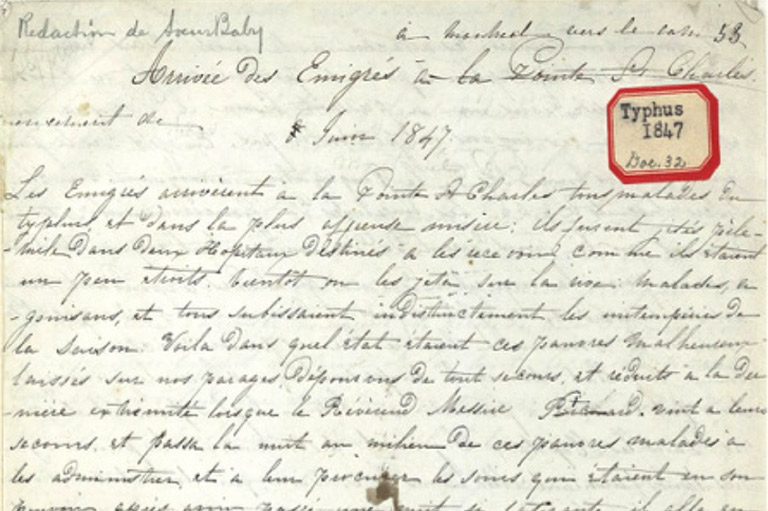L'odyssée des accoucheuses
Faubourg Sainte-Anne, Montréal, 1845. En pleine nuit, une sage-femme et sa fille vont accompagner une femme dans sa délivrance, ce qu’elles répéteront nombre de fois au cours des mois et des années qui suivent. À 16 ans, Flavie entreprend ainsi l’apprentissage du métier auprès de Léonie, sa mère, qui caresse d’audacieux projets : la fondation d’un refuge pour femmes enceintes démunies et celle d’une École de sages-femmes.
Les membres du clergé se méfient comme de la peste de l’esprit d’entreprise de Léonie et de ses collègues. De leur côté, séparés des sages-femmes par leur origine sociale et par leurs préjugés sur les compétences féminines, les médecins amorcent une lutte de pouvoir avec elles afin de leur ravir leur clientèle.

Voilà le cœur du propos de ma saga romanesque Les accoucheuses, dont les trois tomes ont été publiés entre 2006 et 2008, et dont le succès ne se dément pas depuis. Bien des lectrices m’ont demandé si j’avais inventé Léonie et Flavie d’après nature, ou si j’avais simplement fait appel à mon imagination débordante. La réponse, vous la devinez certainement.
Loin d’être le pur produit de mon esprit, mes accoucheuses auraient très bien pu exister, car je les ai façonnées après une patiente recherche dans l’histoire, autant celle du Québec que de l’Europe et des États-Unis. Malheureusement, les sages-femmes ont laissé très peu de traces dans les archives. Il m’a donc fallu documenter leur existence en fouillant un large périmètre sur plusieurs siècles.
Il faut rétablir les sages-femmes dans leur ancienne et légitime possession, écrivait une accoucheuse britannique en 1760, il faut privilégier les voies ordinaires et les plus douces, c’est-à-dire les mains des femmes1. Au moment de la Conquête de l’ancienne Nouvelle-France par la Grande-Bretagne, un débat quasi féministe fait rage en Europe.
Des praticiens mâles privent les accoucheuses réputées de leurs places auprès des riches parturientes. Pour se faire un gagne-pain, les chirurgiens-barbiers, les tailleurs et même les charcutiers ont inventé des instruments – forceps, ventouses – par lesquels ils prétendent suppléer à leur manque de dextérité, à la plus grande taille de leurs mains.
« Ce qui a porté les hommes à inventer de si merveilleuses productions, c’est l’ignorance d’un métier dont ils sont incapables, jointe à la soif de la gloire et de l’argent. Ces moyens toujours aveugles et dangereux sont néanmoins la pierre fondamentale sur laquelle les accoucheurs prétendent statuer la nécessité de préférence, en vertu de laquelle ils s’imaginent être en droit d’arracher des mains des femmes la pratique d’un art que la nature leur a approprié. »
Ces instruments, pourtant, apportent la mort. Car à cette époque, les techniques de désinfection sont minimales. Elizabeth Nihell, l’accoucheuse anglaise, déplore vivement les prétentions des médecins accoucheurs, ainsi que l’aveuglement de leur clientèle qui croit très moderne de remplacer l’ancienne accoucheuse ou accompagnante par un homme prétendument savant.
Dès lors, la table est mise pour le mouvement suprématiste mâle qui va transformer les accoucheuses en accompagnantes incapables d’accomplir le moindre geste médical. Le Québec n’échappe pas à la règle. Jusqu’à la Conquête de 1760, le roi de France envoyait en Nouvelle-France une maîtresse sage-femme qu’il rémunérait. Son savoir était l’aboutissement des générations d’accoucheuses expérimentées qui se sont succédé depuis le commencement des temps.
Au Moyen Âge, quelques abbesses, dont Trotula et Hildegarde de Bingen, transmettent un savoir médical précieux contenu dans les manuscrits savants recopiés à la main et conservés entre les murs des monastères. Les accoucheuses font l’acquisition de leur savoir par apprentissage, exactement comme les médecins.
Dans un Québec devenu colonie britannique, des immigrantes enrichissent le savoir hérité de la maîtresse sage-femme envoyée par le roi de France. Ces professionnelles qui immigrent au Québec ont été formées dans l’une des Maternités d’Europe. Deux maîtresses sages-femmes, exerçant à la Maternité de Paris, ont laissé des traités scientifiques impressionnants : Mémorial de l’art des accouchements (1824), par Marie-Anne Boivin, et Pratique des accouchements (1821), par Marie-Louise Lachapelle.
Les accoucheuses ont alors tout le nécessaire, y compris une science séculaire, pour porter leur pratique à son apogée, au fil des découvertes et du progrès. Sauf que les médecins sont déterminés à prendre leur place. Jusqu’au 19e siècle, leur savoir excessivement dogmatique est élaboré dans des universités sous l’emprise du haut clergé.
Les croyances religieuses sont la base du savoir scientifique; la philosophie et la morale sont les sciences qui priment sur toutes les autres. Pour voler leur pratique aux accoucheuses, les hommes se servent de la philosophie suprématiste chrétienne. Contester ladite suprématie masculine, c’est remettre en question un savoir religieux supposément infaillible et indiscutable, c’est être hérétique.
La théorie médicale en vogue remonte aux Grecs de l’histoire antique. Le corps se compose de quatre humeurs qui doivent s’équilibrer pour entraîner la santé. Naturellement, l’homme est plus sec et chaud que la femme, qui est d’une nature spongieuse, humide et froide.
Par ailleurs, les femmes ont des os plus petits et moins durs, une cage thoracique étroite et un bassin trop large pour marcher sans gêne. La peau est plus fragile, les muscles et les fibres sont mous et, finalement, le cerveau est exigu, surtout dans la zone frontale et au cervelet.
Aristote affirme que la naissance d’un mâle au lieu d’une femelle est un écart de type génétique; naître femme, c’est naître physiquement inachevé. Une femme naît imparfaite, quasiment infirme. Elle possède un sexe interne plus susceptible de faire naître la maladie et les dérèglements. La femme est donc naturellement déficiente.
Une vie génitale plus intense, le mariage par exemple, vient développer l’appareil génital, lui donner toute sa valeur, régulariser et compléter son activité fonctionnelle. Le principe masculin confère la maturité génitale; d’autant plus que la « liqueur masculine » a une action stimulante.
La femme a une physiologie particulière imposée en vue de la maternité. Elle est un animal possédé par le désir d’engendrer. Elle est gouvernée par le plus important organe de son corps : la matrice, qui fait fonction de centre nerveux, comme le cerveau chez l’homme.
Le Dr Guillaume Vallée, un Québécois, écrit en 1826 que la matrice, jouissant d’une grande activité vitale, est exposée à une foule de causes d’irritations et de phlegmasies chroniques dont les suites sont ordinairement fatales2. Si elle se dérègle, la matrice agit sur le corps en entier et même sur l’esprit.
Elle est le siège des passions et des grands désordres de l’âme. À chaque menstruation, des désordres peuvent apparaître : névralgies dentaires, bourdonnement d’oreilles, troubles oculaires, éruptions de peau, irritabilité de l’intestin et même une tuméfaction des corps érectiles du nez.
Un trouble de la menstruation expose toute l’économie du corps à l’intoxication, car la putréfaction intervient quand la circulation sanguine s’interrompt. Le flux menstruel est perçu comme un écoulement de matières infectes. Un médecin écrit : « La menstruation paraît être l’expression ultime excrémentielle des phénomènes sécrétoires internes se passant dans tout l’organisme. »
La matrice a un pouvoir morbide qui relève plus du fantasme que de la preuve scientifique. Pendant la grossesse, les forces destructives de la matrice peuvent s’éveiller à tout moment.
La menstruation ne permet plus l’élimination complète des déchets organiques. Les liquides organiques étant plus riches chez la femme enceinte, la congestion menace. La femme doit éviter de fréquenter les marais, les cimetières, les latrines.
Les médecins imposent donc un savoir non seulement antique, mais indiscutable, car modelé à l’envi par la morale chrétienne. Celle-ci prétend également que l’infériorisation et l’infantilisation des femmes sont la volonté de Dieu. La femme est exclue de la vie publique et subordonnée à l’autorité mâle dans la vie privée. Le clergé surveille la moralité. Dès leur plus jeune âge, les femmes sont soumises à un endoctrinement.
Une bonne chrétienne doit se soumettre aux décrets de la Providence, c’est-à-dire la volonté d’un Dieu justicier dont les décisions sont sans appel. On demande à répétition aux femmes d’accepter avec « reconnaissance, soumission et résignation » les décrets de « l’auteur de toutes nos épreuves », décrets toujours équitables et miséricordieux.
Un médecin de Montréal écrit en 1896 : « La femme en se mariant accepte tacitement toutes les joies et les misères de la vie commune. Elle sait les douleurs qui l’attendent; elle n’ignore pas que sa vie sera souvent exposée; elle connaît la loi inexorable de Dieu : tu enfanteras dans la douleur.
Elle sait tout cela; et par les liens du mariage, elle contracte de sérieuses obligations, entre autres celle d’aimer, de protéger les êtres qui naîtront de cette union; elle doit les protéger, dût-il lui en coûter la vie. »
Un jour, la féministe Marie Gérin-Lajoie rencontre une femme qui a failli mourir à la naissance de son enfant, et qui en est devenue aveugle. Cette femme dit à Marie avec une résignation qui lui va droit au cœur : « Oui, c’est vrai, j’ai beaucoup souffert, mais mon rôle est bien secondaire, après tout mon enfant c’est d’abord l’œuvre de son père, et la preuve c’est qu’il porte son nom et que lui seul en est le maître3. »
Le modèle médical de l’homme géniteur, de l’homme qui utilise la femme comme d’un moule pour porter ses fils, remonte au Moyen Âge. Au début du 20e siècle, ce modèle résiste encore. Des femmes croient que seul le père crée l’enfant et lui imprime un caractère. Quand Marie y oppose la théorie égalitaire dans l’œuvre de la génération, on l’accuse de vouloir bouleverser la famille.
L’idée de la femme servant uniquement de réceptacle est constamment réactualisée par les médecins, même si la science finit par comprendre le mécanisme de production des ovules. Les préjugés, les superstitions et les tabous alimentent le scepticisme pour la nouveauté scientifique.
La reconnaissance de l’égalité des rôles biologiques menace l’ordre des choses. Dès la décennie 1830, il est reconnu que la femme est mensuellement apte à la maternité; pourtant, c’est l’occasion de la disqualifier comme partenaire égale de l’homme; son appareillage particulier est perçu comme un obstacle à l’égalité.
Au fil du 19e siècle, le haut-clergé québécois va s’installer au sommet du pouvoir. Le haut-clergé et le gouvernement exécutif travaillent main dans la main. Les instructions religieuses nommées mandements deviennent des ordres absolus. La société se sacralise; les curés et les communautés religieuses se multiplient.
Le nombre élevé de serviteurs et de servantes de Dieu impose un despotisme au quotidien. Le mot « indécence » prend une connotation très large. Les femmes sont devenues subordonnées partout : dans leurs fonctions publiques comme dans la sphère de l’intime. Même fortunées, elles sont littéralement corsetées au physique comme au moral.
Désormais, les sages-femmes doivent suivre une formation sous la supervision des médecins et réussir les examens devant le Bureau provincial de médecine. Seule cette formation leur donne accès aux hôpitaux de maternité. Hors des grands centres, elles peuvent pratiquer légalement si deux médecins donnent leur accord.
En 1880, le Bureau provincial de médecine décrète l’incompétence médicale de la sage-femme, qui n’a plus que le droit de faire des accouchements et non pas de pratiquer la médecine, même si le cas résulte directement de l’accouchement. Peu à peu, les sages-femmes disparaissent des villes, puis des campagnes.
Certaines accoucheuses adoptent la stratégie de devenir religieuses. On peut la considérer comme une mise en tutelle ou comme une stratégie de survivance; la réalité est sans doute un mélange des deux.
En fait, c’est une stratégie gagnante. Dans le monde catholique québécois, les institutions gérées par des dames laïques vont disparaître. Des bourgeoises anglophones avaient fondé la Quebec Female Compassionate Society et le University Lying-In, des refuges pour femmes démunies enceintes.
La veuve Rosalie Cadron-Jetté avait fondé un troisième refuge semblable, tandis qu’Émilie Tavernier-Gamelin se consacrait aux femmes âgées sans ressources. Les deux premiers refuges vont disparaître; les deux derniers vont devenir les communautés des Sœurs de la Miséricorde et des Sœurs de la Providence. Même à la Miséricorde, les « bonnes sœurs » finissent par perdre leur rôle d’antan. À partir de la fin du 19e siècle, ce sont les médecins qui accouchent.
La mise en tutelle des femmes est devenue légaliste et règlementaire. Une femme qui travaille sans nécessité absolue est une voleuse de jobs; ou bien les professionnels leur confient ce qu’ils jugent indigne d’eux, comme secrétaire, adjointe, etc. Les sages-femmes sont devenues des infirmières, considérées par les médecins comme leurs auxiliaires.
Les hommes s’instruisent, vont à l’université, découvrent de nouvelles disciplines scientifiques ou sociales, de nouveaux champs d’expertise, tandis que des dizaines de milliers de femmes sont enfermées dans les couvents. Le suffrage universel masculin est gagné, tandis que les femmes en sont exclues. Les curés, les prêtres et les prélats sont partout dans la société civile. Les théories de suprématie masculine sont devenues science et dogme.
C’est à l’apogée de ce régime de contrôle masculin que commence l’assaut féministe, grâce à une première génération de femmes nommées Marie Gérin-Lajoie, Joséphine Dandurand, Caroline Béïque, Carrie Derrick.
Les féministes de la génération suivante sont davantage connues : Thérèse Casgrain et Idola Saint-Jean. Si la lutte féministe a été si longue et si dure, c’est à cause de l’étroite collusion entre le pouvoir religieux et le pouvoir étatique, à cause de préjugés tenaces ancrés dans le dogme de la suprématie mâle confirmée par la science et la morale. L’interdit légal est levé en 1955; la pleine jouissance des droits civils n’est acquise qu’en 1964.
Les sages-femmes, elles, commencent à réclamer leur réinsertion dans le système de santé au tournant des années 1980. Au cours des décennies précédentes, la société québécoise a été profondément bouleversée par le passage de la Révolution tranquille. Certes, le Québec n’a jamais été complètement à l’écart de la modernité; les artistes, par exemple, ont commencé à brasser la cage dès les années 1930.
Il faudra cependant qu’une génération, celle du Baby-Boom de l’après-Deuxième Guerre mondiale, renverse les idoles du passé, celles qui portaient soutanes et mitres, celles qui dirigeaient la province depuis le trône épiscopal ainsi que depuis les chaires d’églises et d’universités.
Pendant les années 1960, les médecins ont-ils remplacé les prêtres comme gardiens de la moralité? Chose certaine, ils semblent avoir pris leur place pour nous protéger de nos plus grandes peurs, celles de la souffrance et de la mort. Peut-être à cause de la technologie triomphante, ils se sont installés au faîte du pouvoir, ils sont devenus les détenteurs de la profession la plus prestigieuse, la plus socialement convoitée.
Voilà pourquoi il a fallu du temps et du courage à des sages-femmes, qui jusque-là exerçaient dans l’illégalité, pour défier leur monopole. Petit à petit, les accoucheuses gagnent du terrain. Elles peuvent aujourd’hui exercer en maison des naissances ou à l’hôpital, elles peuvent étudier à l’université.
Leur champ d’intervention est encore trop restreint, mais l’espoir est de mise. Léonie et Flavie, mes héroïques accoucheuses du 19e siècle, se sentiraient presque chez elles…
Thèmes associés à cet article
Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Traces de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ).