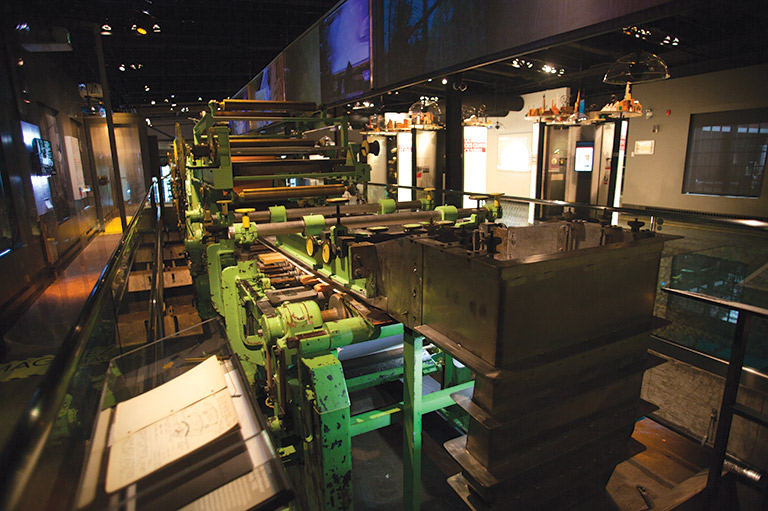Là où s'arrêtent les cageux se dressent des villages

L’histoire et le développement du Québec sont intimement liés à ses cours d’eau. L’édification et la formation des premières seigneuries et des premiers villages se sont faites en grande partie à proximité des cours d’eau, notamment des rivières, pour une multitude de raisons.
L’irrigation des terres, la facilité du transport des personnes ou des biens matériels, l’accès aux produits de la pêche et bien sûr pour les besoins quotidiens en eau.
Il s’agit là de quelques-unes des nombreuses raisons ayant poussé les habitants et les seigneurs à s’établir à proximité de cette ressource vitale.
Même si de nombreux villages ou seigneuries se sont à peu près tous développés sur le même modèle en Nouvelle-France ou au Bas-Canada à travers les années, certains endroits font exception et ne suivent pas tout à fait ce canevas.
Prenons, à titre d’exemple, le village de l’Abord-à-Plouffe, qui se situe sur l’île Jésus, île qui constitue aujourd’hui, dans son entièreté, la ville de Laval. Ce village, d’abord intégré à la paroisse de Saint-Martin, devint un village à part entière en 1915.
Lui aussi établi à proximité d’un cours d’eau, dans ce cas-ci la rivière des Prairies, il s’est développé en partie grâce à un autre facteur : la présence des cageux. Car là où s’arrêtent les cageux se dressent des villages.
Le commerce du bois
En plus de se développer au bord des cours d’eau, plusieurs autres facteurs ont favorisé la création de différents villages, par exemple l’exploitation d’une ressource naturelle. La proximité avec une ressource telle que le bois, la pierre ou les métaux encourageait l’arrivée massive d’habitants et d’entrepreneurs venus travailler à l’exploitation de ces ressources.
Bien entendu, cela créait des besoins pour les hommes venus s’établir dans le secteur et, dans bien des cas, un village prenait forme, avec un magasin général, un bureau de poste, un forgeron et autres commodités nécessaires à la vie quotidienne.
Au village de l’Abord-à-Plouffe, la situation fut un peu semblable et le développement du village se fit en grande partie grâce au commerce du bois.
Pour mieux saisir les raisons pour lesquelles le commerce du bois a été un facteur de développement important dans ce secteur, il faut comprendre le contexte politique et économique de l’époque.
La décennie de 1760 marque un tournant majeur pour la Nouvelle-France. Après la Conquête en 1760, la colonie passe des mains de la France à l’Angleterre. Le traité de Paris de 1763 met un terme à la guerre de Sept Ans, officialisant la cession des territoires français à l’Empire britannique.
Puis, avec la Proclamation royale, délivrée quelques mois plus tard, l’Angleterre entend réorganiser les territoires d’Amérique du Nord qu’elle vient d’acquérir, en créant notamment la Province of Quebec.
Le territoire de l’ancienne Nouvelle-France portera ce nom jusqu’en 1791, où l’Acte constitutionnel amena la création du Bas-Canada et du Haut-Canada.
Ce court rappel historique fixe quelques balises pour expliquer le changement de garde qui s’opéra au Canada. À présent colonie britannique, ce territoire, qui deviendra ultérieurement le Canada, devait désormais transiger avec un nouvel empire.
Ce détail devient important en 1806, alors que Napoléon, empereur français, met sur pied le Blocus continental dans le but avoué de ruiner l’Angleterre en l’empêchant de commercer avec le reste de l’Europe.
Les ports de la mer du Nord et de la mer Baltique furent alors fermés aux bateaux anglais. Isolée sur son île, l’Angleterre se retrouva ainsi à court de ressources, dont le bois. C’est à ce moment que l’Empire britannique s’est tourné vers ses colonies afin de s’approvisionner de cette ressource essentielle à la construction de navires de guerre.
Pour le Bas-Canada, il s’agissait là d’une occasion en or de commercer, puisque la région des Outaouais possédait une des plus importantes forêts de pins qui, avec le chêne, étaient les deux familles de bois les plus en demande.
Les commerçants de la colonie y ont vu une opportunité pour faire de l’argent et ont rapidement commencé à organiser l’exploitation et l’exportation du bois des Outaouais vers l’Angleterre.
Les camps de bûcherons ont vu le jour dans la région, notamment grâce à l’exploiteur et homme d’affaires Philemon Wright, qui créa la société Philemon Wright & Sons, devenue la Wright, Batson and Currier de Hull au fil des différentes associations.
Les hommes partaient travailler dans le bois à la fin de l’automne et durant l’hiver. Dès le printemps, on pouvait finalement transporter les immenses troncs d’arbre vers Québec.
Voyager sur les rivières
Le transport du bois vers Québec était une organisation complexe à l’époque où le chemin de fer n’était pas encore répandu sur le territoire canadien. L’acheminement de la ressource vers le port de la capitale devait se faire par voie maritime.
C’est donc en descendant les rivières que les troncs de pins et de chênes se rendaient à destination. L’une des activités bien présentes dans l’histoire et l’imaginaire collectif au Québec est la drave. On serait ainsi porté à croire que ce sont les draveurs qui dirigeaient le bois de Hull à Québec.
Or, il n’en fut rien. La raison en est bien simple : de Hull à Montréal, les cours d’eau sont parsemés de rapides et de chutes qui rendent la drave impossible. Trop dangereuse pour les hommes, elle aurait également entraîné le bois à se fracasser dans les bas-fonds.
De surcroît, le chêne, l’un des deux types de bois prisé par l’Angleterre, est un bois lourd, qui coule. Il se serait donc retrouvé au fond des rivières. C’est ici qu’entrent en scène les cageux.

Pour parvenir à transporter le bois jusqu’à Québec, les bûcherons attachaient ensemble les troncs d’arbre, pour former des radeaux, que l’on appelait cribes ou drames. On attachait ensuite ces structures ensemble pour former ce que l’on appelait les cages. Et ce sont les cageux qui dirigeaient ces cages jusqu’au port de Québec.
Chaque radeau était formé de deux séries de rangées de troncs d’arbre. Comme le chêne est un bois qui coule et que le pin, lui, flotte, on cordait les troncs de pins en dessous, puis, ceux de chênes en une deuxième rangée, au-dessus.
De cette manière, on s’assurait que le chêne ne traîne pas au fond de l’eau. Les cages, cette succession de radeaux attachés les uns aux autres, pouvaient être composées de 20 à 100 radeaux, transportant ainsi parfois jusqu’à 2 000 billots en une seule expédition.
Le nombre d’hommes voyageant sur les cages pouvait également varier, allant d’une trentaine à près de 100 hommes. Sur les cages, on retrouvait un aménagement servant de cuisine et des tentes étaient installées pour abriter les cageux, puisque le voyage durait plusieurs jours.
Les cageux avaient donc le nécessaire à la vie quotidienne sur les cages. Les repas étaient principalement composés de fèves au lard, que les hommes préparaient sur le feu, dans un gros chaudron.
Pour éviter les incendies, du sable était transporté sur les radeaux, pour éteindre le feu et y plonger les chaudrons brûlants.
Aux temps les plus forts de ce commerce, le voyage entre les Outaouais et Québec prenait environ six jours. Cependant, les premières expéditions prirent environ deux mois à se rendre à Québec.
Il faut comprendre que la rivière des Outaouais était difficilement praticable avec ses nombreux rapides. Avec les années, les entrepreneurs construisirent des systèmes de glissoires qui permettaient aux radeaux de traverser les rapides, un à la fois, de manière plus sécuritaire.
D’ailleurs, les cageux étaient équipés d’immenses rames de 10 mètres, pour diriger les cages et les éloigner des côtes.
En temps calme, les cages se laissaient porter par le courant, parfois même par le vent avec un système de voiles, ou encore elles étaient tirées par des chaloupes en l’absence de bourrasques. Mais l’arrivée dans les rapides entraînait des déplacements plus difficiles.
Aborder la terre
À l’approche des rapides, les cageux devaient alors accoster sur les côtes des rivières et désassembler les cages pour traverser les rapides, un radeau à la fois.
Un processus assez laborieux considérant que les cages pouvaient être composées de dizaines de radeaux. Les cageux descendaient donc les passages plus dangereux, radeau par radeau, puis, ils réassemblaient les cages et poursuivaient leur chemin.
Ils pouvaient ainsi aborder la terre de différents villages lors de leurs passages. C’est ici que nous retrouverons le village de l’Abord-à-Plouffe.
Sur l’île Jésus, au bord de la rivière des Prairies, on retrouvait le village de l’Abord-à-Plouffe. Situé approximativement aujourd’hui entre les quartiers Chomedey et Laval-des-Rapides, entre le boulevard Curé-Labelle et l’autoroute 15, ce village aux abords de la rivière était établi entre différents rapides, notamment le Gros-Sault et Sault-au-Récollet.
Il se trouvait également pratiquement à mi-chemin entre Hull et Québec, ainsi qu’à proximité de Montréal, ce qui en faisait un arrêt d’autant plus intéressant.
Pour traverser les différents rapides du secteur, les cageux auraient alors abordé la terre de la famille Plouffe. S’il ne s’agissait que d’un arrêt de passage au départ, aborder à ce village devint rapidement un incontournable pour les voyageurs des rivières.
Les cageux en profitaient pour faire le plein de provisions, nourriture ou matériaux, faire réparer des outils ou encore soigner des hommes malades. On recrutait même parfois de nouveaux cageux pour remplacer les blessés.
L’Abord-à-Plouffe s’est ainsi particulièrement développé tout au long du XIXe siècle grâce aux nombreuses escales des cageux.
Si les voyageurs n’étaient que de passage au départ, la situation changea rapidement. Tout d’abord, après avoir livré le bois à Québec, les cageux devaient revenir vers les Outaouais, parfois par bateau, d’autres fois par carriole.
L’arrêt à l’Abord-à-Plouffe était également de mise sur le chemin du retour. De plus, le commerce du bois était un travail saisonnier.
On bûchait dans les forêts durant l’hiver, on transportait le bois au printemps, mais à l’arrivée de l’été jusqu’à l’automne, la majorité des bûcherons et des cageux se retrouvaient sans emploi.
Grâce aux liens créés à l’Abord-à-Plouffe, plusieurs voyageurs revenaient au village pendant la saison estivale et la saison des récoltes pour aider et travailler avec les habitants et les cultivateurs.
La proximité avec Montréal permettait également d’aller trouver des emplois en ville. La plupart des cageux logeaient chez les habitants au départ. Puis, certains ont commencé à s’établir dans le village, à s’y installer et à fonder une famille.
À la fin de l’automne, ils retournaient vers les Outaouais pour reprendre le travail du bois et revenaient au village vers la fin du printemps. Au plus fort de ce commerce, deux familles sur cinq voyaient leur chef de famille s’engager comme cageux.

Une époque révolue
Le travail de cageux sera finalement voué à disparaître vers la fin du XIXe siècle avec l’apparition des chemins de fer, moyen de transport plus rapide et plus efficace pour le bois.
Ce métier aujourd’hui disparu et assez méconnu, fut cependant d’une grande importance dans le commerce du bois du Bas-Canada, mais aussi dans le développement d’un village en particulier, celui de l’Abord-à-Plouffe.
On suppose que d’autres villages ont également pu croître au fil du passage des cageux, mais on en retrouve malheureusement peu de traces aujourd’hui. Il est néanmoins fort intéressant de s’attarder à ce métier disparu, bien que l’on doive porter attention à démêler les faits du folklore.
Car, sans que l’on s’en doute, les légendes québécoises nous parlent entre autres des cageux par l’entremise de l’un de leur plus célèbre représentant, le plus grand que nature, Jos Montferrand.
Thèmes associés à cet article
Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Traces de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ).