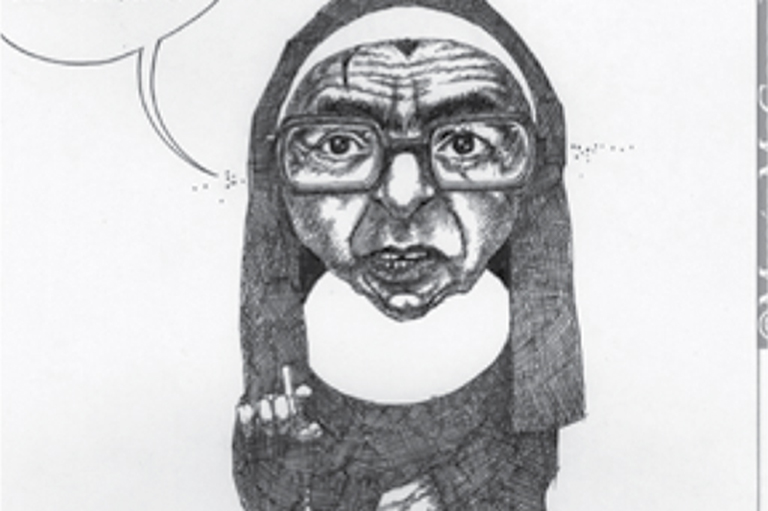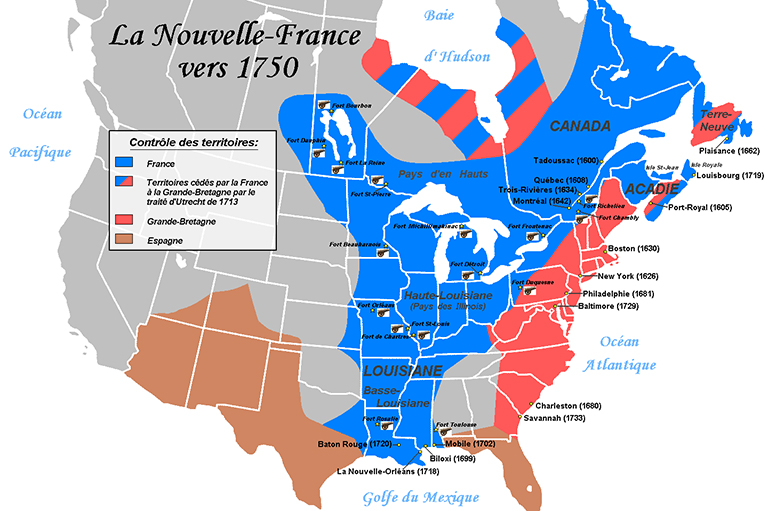L’empathie historique — Le concept le plus important lors de l’apprentissage de la pensée historique
NOTE : ce texte a tout d’abord été proposé lors de la conférence des étudiants diplômés francophones du The History Education Network/Histoire et Éducation en Réseau (THEN/HiER), à Québec le 25 octobre 2012.

À l’été 2011, je me suis rendue en Angleterre pour une conférence. J’ai organisé mon voyage de façon à avoir quelques jours pour explorer Londres et ses environs et, par une belle journée ensoleillée, me voilà à Greenwich, où se trouve le méridien d’origine et le « Greenwich Mean Time ». Alors que je me promenais sur le campus de l’université de Greenwich, sur le terrain de l’Old Royal Navy College, j’ai aperçu cet objet intrigant (voir image).
Le panneau sur le côté indiquait : « D-Day Landing Experience ». En tant qu’ancienne enseignante, et maintenant formatrice d’enseignantes d’histoire et de sciences sociales, je me suis mise à me poser mille questions : les gens pensent-ils vraiment qu’un « tour » de deux minutes dans cet engin peut reproduire l’expérience des soldats débarqués sur les côtes de Normandie (nord de la France) pour lancer l’une des batailles les plus épiques de la Seconde Guerre mondiale ?
Comment peut-on croire que le fait de s’assoir dans cette boite en métal reproduira les expériences et les émotions de ceux qui ont vécu l’évènement ? À part peut-être causer une certaine nausée, les gens en sortiraient-ils vraiment en se disant : « Maintenant, je sais ce que c’était d’être un soldat le jour J » ?
Il semble impossible que quelqu’un ressorte de cette expérience avec cette impression, et pourtant nous savons que certains y croient. C’est comme quand les gens sortent d’un film portant sur un personnage, un évènement ou une période historique en se disant : « Si j’avais été elle, j’aurais fait les choses différemment. Pourquoi n’a-t-elle pas simplement essayé de s’échapper ? »
Personne ne fait mieux comprendre ce point que Primo Levi, qui, dans son livre The Drowned and the Saved, décrit une rencontre avec un élève de cinquième année lors d’une rencontre portant sur son expérience des camps de concentration : « Un garçon au regard alerte, apparemment en tête de sa classe, me posa la question obligatoire : “Mais comment se fait-il que vous ne vous soyez pas échappé ?”
Je lui ai brièvement expliqué ce que j’ai écrit ici. Pas tout à fait convaincu, il m’a demandé de dessiner au tableau un croquis du camp indiquant l’emplacement des tours de garde, des portes, des barbelés et de la centrale électrique. J’ai fait de mon mieux, sous le regard de trente paires d’yeux attentifs.
Mon interlocuteur a étudié le dessin pendant quelques instants, m’a demandé quelques précisions supplémentaires, puis il m’a présenté le plan qu’il avait élaboré : ici, la nuit, égorger la sentinelle ; ensuite, mettre ses vêtements ; immédiatement après, courir là-bas vers la centrale électrique et couper l’électricité, de sorte que les projecteurs s’éteignent et que la clôture à haute tension soit désactivée ; après cela, je pourrais partir sans problème.
Il a ajouté sérieusement : “Si cela devait vous arriver à nouveau, faites ce que je vous ai dit. Vous verrez que vous serez capable de le faire” ». (Levi, 1988, p. 150-151)
Ce problème — celui d’essayer de comprendre la mentalité des personnes du passé — est un problème d’empathie historique (parfois appelé prise de perspective historique). On a beaucoup écrit sur le concept d’empathie historique pour tenter de le définir et de montrer la capacité des élèves à s’engager dans une compréhension historique empathique.
Certains auteurs utilisent différents termes pour désigner le même concept (empathie, prise de perspective historique, par exemple) et la plupart conviennent que délimiter ce que signifie l’empathie n’est pas une tâche facile. Ashby et Lee (1987) la définissent comme « un accomplissement : c’est le point où nous arrivons lorsque nous avons réussi à reconstruire les croyances, les valeurs, les objectifs et les sentiments d’autrui » (p. 63).
Ils affirment que la compréhension empathique du passé n’est pas un processus, mais un résultat, bien que Yeager et Foster (2001) pensent qu’elle soit les deux. Seixas (1996) explique que l’empathie consiste à comprendre que « les gens du passé n’ont pas seulement vécu dans des circonstances différentes… mais ont également vécu et interprété le monde à travers des systèmes de croyances différents » (p. 774).
Pour parvenir à cette compréhension, il faut généralement disposer de nombreuses connaissances sur le passé et des compétences nécessaires pour interpréter les sources historiques avec empathie.
L’un des plus gros obstacles à la compréhension empathique est l’imposition de valeurs, de croyances et d’attitudes présentistes aux acteurs et aux situations du passé. C’est là le « paradoxe de l’empathie », qui « implique un effort pour affronter la différence qui, à chaque fois, nous tente d’imposer nos propres cadres de signification aux autres » (Seixas, 1996, p. 775-776).
Ashby et Lee (1987) expliquent clairement la nature de cette difficulté : « s’intéresser aux croyances, aux objectifs et aux valeurs d’autres personnes ou — dans la mesure où l’on peut parler ainsi — d’autres sociétés est une réalisation intellectuelle difficile. Difficile parce qu’elle implique de garder à l’esprit des structures entières d’idées qui ne sont pas les siennes, et avec lesquelles on peut être en profond désaccord.
Et ne pas les garder à l’esprit comme un savoir inerte, mais être en mesure de travailler avec elles pour expliquer et comprendre ce que les gens faisaient dans le passé. » (p. 63) Cependant, la plupart des auteurs qui écrivent sur ce sujet sont optimistes et pensent que même cette difficulté peut être surmontée par un enseignement approprié et la participation à des activités qui poussent les élèves à examiner leurs propres processus de pensée lorsqu’ils travaillent avec des sources historiques et tentent de comprendre des situations du passé (Ashby et Lee, 1987 ; Barton, 1996 ; Lee et Ashby, 2001 ; Portal, 1987 ; Yeager et Foster, 2001).
L’empathie en tant qu’objet de recherche, quant à elle, pose plusieurs problèmes à ceux qui s’y intéressent, car pour développer l’empathie, les élèves doivent s’appuyer sur leur compréhension du contexte, de l’agentivité, des preuves et de l’épistémologie (Ashby & Lee, 1987 ; Foster & Yeager, 1999 ; Portal, 1987 ; Yeager & Foster, 2001).
Par conséquent, de nombreux projets de recherche qui ont pour objet un autre élément de la compréhension historique peuvent aussi traiter en même temps de l’empathie, de la prise de perspective et du jugement éthique.
Cela dit, de nombreux chercheurs ont choisi l’empathie historique comme objet de recherche (Ashby & Lee, 1987 ; Barton, 1996 ; Davis Jr, Yeager, & Foster, 2001 ; Doppen, 2000 ; Foster & Yeager, 1998 ; Lee & Ashby, 2001 ; Levstik, 2001 ; Ogawa, 2001 ; Yeager & Doppen, 2001 ; Yeager, Foster, Maley, Anderson, & Morris III, 1998).
En se basant sur leur propre recherche et en s’inspirant d’études antérieures menées au Royaume-Uni, Ashby et Lee (1987) ont établi cinq catégories hiérarchiques de la compréhension et du développement de l’empathie des élèves en histoire.
Ils prennent soin d’avertir les lecteurs que ces catégories ne sont pas des stades de développement et notent que les enfants peuvent opérer à différents niveaux de la hiérarchie en fonction d’un certain nombre de variables, dont leur degré de familiarité avec le sujet ou la tâche, la force de leurs propres opinions sur le passé et l’influence des autres (élèves, enseignantes) sur leur pensée.
Au premier niveau de la hiérarchie, les élèves supposent généralement que les personnes et les institutions du passé n’étaient pas aussi intelligentes qu’eux (ou qu’une personne de leur connaissance) et que c’est la raison pour laquelle elles ont agi ou pensé comme elles l’ont fait. Le deuxième niveau est caractérisé par un raisonnement qui utilise des stéréotypes, non étayés par des preuves, pour expliquer les actions d’un agent historique.
Les élèves dont la pensée se situe dans la troisième catégorie sont capables de comprendre les actions en relation avec leur situation spécifique « mais la situation est vue en termes modernes, sans distinction entre la façon dont nous la voyons et la façon dont les contemporains l’auraient vue, ou entre ce que l’agent ou les agents savaient et ce que nous savons maintenant » (Ashby & Lee, 1987, p. 74).
Le quatrième niveau se caractérise par la compréhension du fait que les personnes et les actions du passé doivent se comprendre dans leur propre contexte, et non comme nous les conceptualisons aujourd’hui. En d’autres termes, les élèves saisissent que nous, dans le présent, savons des choses que les gens du passé ignoraient et qu’il est impossible qu’ils aient pu les savoir (ils n’étaient pas simplement « stupides »).
Au plus haut niveau de compréhension empathique, les élèves peuvent comprendre les acteurs et les situations spécifiques dans un contexte sociopolitique et historique plus large. Ils établissent alors des distinctions claires entre les points de vue, les connaissances, les systèmes de croyances, etc. de l’historien et de l’agentivité.
Et si plusieurs chercheurs ont constaté que la tendance des élèves à voir le passé à travers le prisme du présent constitue un énorme obstacle au développement de l’empathie historique, il existe des lueurs d’espoir d’amélioration (Barton, 1996 ; Lee & Ashby, 2001).
Dans l’étude de Lee et Ashby, certains des élèves de deuxième année participant au projet « se comportaient comme s’ils croyaient que même des institutions déroutantes comme celles des tâches pouvaient être rendues intelligibles en comprenant comment les gens voyaient leur monde » (p. 37).
Bien que ce type de réflexion soit plus typique des élèves plus âgés, les auteurs soulignent « combien il serait erroné pour les enseignantes d’avoir de faibles attentes envers les enfants plus jeunes » (p. 37). Et Barton note que « l’une des caractéristiques les plus frappantes des élèves [de son étude] est que leur réflexion a rapidement atteint des niveaux plus élevés [de compréhension empathique] » (p. 23).
Cela ne veut pas dire que les élèves de toutes les études présentées ici n’ont pas rencontré de difficultés. Par exemple, Barton ajoute que, bien que certains élèves aient réalisé que les croyances et les systèmes de valeurs étaient différents dans le passé, ils avaient du mal à comprendre pourquoi il en était ainsi.
La recherche sur la compréhension de l’empathie par les élèves, bien qu’elle soit plus solide que d’autres domaines s’intéressant à la compréhension historique, pourrait bénéficier d’un plus grand nombre d’études consacrées à la découverte des processus par lesquels les élèves commencent à les utiliser lorsqu’ils développent la capacité d’empathie avec les acteurs du passé.
On devrait accorder une attention particulière aux déclencheurs ou aux incitations qui semblent efficaces pour faire passer les élèves d’un niveau naïf à un niveau plus sophistiqué de raisonnement empathique, car ils intéresseront sans aucun doute les professeurs d’histoire et les concepteurs de programmes. Mais que fait la recherche actuelle pour répondre à ces questions ?
En 2019, j’ai obtenu une subvention de partenariat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada intitulée « Penser historiquement pour l’avenir du Canada. » Quelque 27 cochercheurs et plus de 30 organisations partenaires se sont joints à moi dans le but de mieux comprendre l’état actuel de l’enseignement de l’histoire à travers le pays (phase 1) et, plus tard, d’étudier les pratiques innovantes d’enseignement de l’histoire de la maternelle à la 12e année (phase 2).
Notre recherche, qui se déroule en français et en anglais, s’articule autour de trois axes subdivisés en trois thèmes. Les axes de recherche sont les suivants : Programme et ressources, Enseignement et apprentissage (recherche en classe), et Formation des enseignants.
Les trois thèmes traversant chaque axe de recherche sont les suivants : la théorie de la pensée historique, l’intégration des savoirs indigènes et l’enseignement de l’histoire pour l’engagement civique (?). Nous sommes actuellement dans la phase 1 de la recherche et bien que, comme tout le monde, notre travail ait quelque peu été affecté par la pandémie mondiale, nous allons de l’avant et prévoyons lancer une enquête pancanadienne auprès des enseignantes et des étudiantes, avec des questions axées sur les trois axes de recherche et les trois thèmes mentionnés plus haut.
Nous planifions également ce que nous appelons des « portraits de la pratique professionnelle » pour lesquels nous prévoyons interviewer un large éventail d’enseignantes à tous les niveaux de la maternelle à la 12e année et dans de nombreux contextes différents afin de « donner vie » aux données de l’enquête.
Nous sommes impatients de travailler avec des enseignantes et des étudiantes de tout le pays à mesure que nous avançons dans notre travail. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Penser historiquement pour l’avenir du Canada.
Thèmes associés à cet article
Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Enjeux de l’univers social de l’Association québécoise pour l’enseignement de l’univers social (AQEUS).