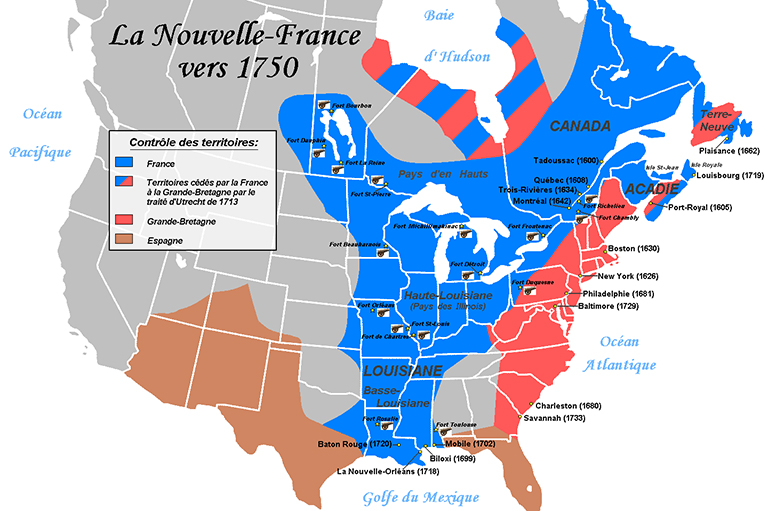Histoire du Canada sous l'angle de la l'identité et du bilinguisme
Ceci est une retranscription des notes de l’allocution d’ouverture prononcée par monsieur Graham Fraser au congrès conjoint de l’AQEUS et de l’Association d’études canadiennes (AEC), à Bromont, le 17 octobre 2013. Seul le text prononcé fait foi.
J’ai le grand plaisir d’être parmi vous aujourd’hui à Bromont pour discuter de l’importance de voir notre histoire commune sous l’angle de l’identité et du bilinguisme.
L’enseignement de l’histoire est une question qui m’a toujours passionné, quand j’étais étudiant, puis comme journaliste et, maintenant, comme commissaire aux langues officielles.
Et en cette ère de mondialisation, où la migration est devenue la norme et où la communication est instantanée, il me semble que la notion d’identité revêt une importance primordiale.
Il y a 46 ans, mon père a publié un livre sur le Canada de l’après-guerre au centenaire de la Confédération, soit de 1945 à 1967. Ce livre, qu’il avait intitulé The Search for Identity, se terminait par des citations de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme :
Le Canada traverse actuellement, sans toujours en être conscient, la crise majeure de son histoire… tout se passe comme si l’état des choses établi en 1867 et jamais gravement remis en question était pour la première fois refusé par les Canadiens français du Québec. Qui a tort et qui a raison? C’est une question que nous ne nous posons même pas : nous nous contentons d’enregistrer le fait de la crise qui nous paraît très grave. Si elle persiste et s’accentue, elle peut conduire à la destruction du Canada. Si elle est surmontée, elle aura contribué à la renaissance d’un Canada plus dynamique et plus riche1.
À la suite de ces citations, l’auteur, mon père, a ajouté une observation sur les tensions qui ont toujours existé entre les divers peuples du Canada : « Jamais, dans leur histoire, les Canadiens n’ont manifesté beaucoup de tendresse les uns pour les autres. Leurs loyautés ont toujours été paroissiales et leurs hostilités mutuelles chroniques2. »
Par ces paroles, il se faisait l’écho de l’historien canadien Arthur Lower qui avait écrit qu’à l’époque de la Confédération, la haine était vue comme une vertu.
Mais pour mon père, comme il l’avance en conclusion, la constante proximité de la nature sauvage est l’élément qui a véritablement formé notre identité collective profonde.
En finissant sur cette note, celle de l’identité collective, mon père nous donnait une raison de nous élever au-delà des conflits interrégionaux et interethniques, de nous libérer de la haine ancestrale entre les Anglais et les Français, pour faire de ce pays du Nord une réalité rassembleuse.
J’ai donc grandi avec cette vision quelque peu romantique de l’identité canadienne et cette autre vision, parallèle et plus sceptique, de la capacité des peuples du Canada de s’entendre.
Étudiant en histoire, j’ai fait des recherches sur la grève des réalisateurs de Radio-Canada en 1958. Plus tard, pour ma maîtrise, j’ai étudié l’histoire de l’aménagement urbain à Toronto et l’histoire intellectuelle du Canada. Tout cela m’a permis de mieux comprendre l’importance des diverses versions de nos expériences collectives.
Et depuis que je suis commissaire aux langues officielles, je m’efforce de présenter l’histoire de la dualité linguistique canadienne sous un angle différent de la vision traditionnelle, qui englue les anglophones et les francophones dans une relation inévitablement conflictuelle.
Pour moi, l’histoire est intimement liée à la question de l’identité collective. Même dans le présent, une communauté n’échappe pas à son passé.
Comme disait William Faulkner dans son discours d’acceptation du Prix Nobel, le passé n’est jamais mort; il n’est même pas passé.
Or, ce passé n’est pas uniquement fait de victoires ou, comme dit notre hymne national, une épopée des plus brillants exploits.
L’ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson disait souvent aux immigrants que le Canada n’est pas un buffet où l’on peut ne prendre que les bons morceaux. C’est aussi vrai de l’histoire du Canada; il faut l’assumer dans sa totalité, avec ses hauts faits et ses moments moins glorieux.
Si les Patriotes, LaFontaine et Baldwin, Jean Lesage, Pierre-Elliot Trudeau et René Lévesque font partie de notre histoire, il en est de même des pensionnats pour autochtones, des émeutes antisémites à Toronto et à Montréal dans les années 1930, de l’internement des Japonais dans les années 40 et de la crise d’Octobre en 1970. Notre identité est diverse et complexe, avec des éléments sombres et d’autres, pleins de lumière.
Bien comprendre notre histoire n'est pas facile. Il est plus simple de raconter des révolutions qu'une évolution graduelle; les rebelles sont plus accessibles et retiennent plus l’attention que les conciliateurs.
De fait, il est facile de trouver, dans l’histoire canadienne, des récits où les questions linguistiques mènent à des conflits.
Certains penseurs interprètent l’histoire comme une suite de tentatives pour éliminer la langue française :
- la conquête anglaise;
- la répression de la rébellion de 1837;
- la recommandation de lord Durham en 1839 d’assimiler les Canadiens français le plus rapidement et le plus efficacement possible;
- la pendaison de Louis Riel en 1885;
- l’adoption par l’Ontario en 1912 du règlement 17;
- l’interdiction de l’instruction dans une langue minoritaire dans les écoles manitobaines en 1916;
- la crise de la conscription en 1917 et la suite de cette crise en 1942;
- la Loi sur les mesures de guerre en 1970,
- sans oublier la nuit des longs couteaux en 1981, comme certains l’ont appelée.
Oui, il est facile de faire ressortir une constante entre tous ces événements : le conflit, comme si l’histoire canadienne n’était que ça.
Comme l’a clairement expliqué Christian Dufour dans son livre Le défi québécois, paru en 1989, la conquête demeure un point d’ancrage important de la pensée intellectuelle au Québec.
Dans le même ordre d’idées, la révolte des Patriotes est présentée sous un jour dramatique dans le film 15 février 1839 de Pierre Falardeau.
Lorsque Sir John A. Macdonald a refusé de commuer la sentence d’exécution prononcée contre Louis Riel, on pouvait lire dans un journal du Québec : « Riel n’est qu’un nom : c’est l’élément canadien-français et catholique qu’on veut faire danser au bout de la corde3. »
Et Honoré Mercier, alors chef du Parti libéral du Québec et plus tard premier ministre de la province [de Québec], a déclaré, lors d’une grande manifestation à Montréal, que l’exécution avait « frappé notre race au cœur ».
Le Parti conservateur a mis un siècle à se remettre des effets du choc causé par cette pendaison.
Aujourd’hui, j’aimerais vous proposer une appréhension différente de l’histoire, en faire un compte rendu plus positif, un récit fondé sur l’inclusion et le respect. Et j’espère, ce faisant, ouvrir une autre voie de réflexion sur l’enseignement de l’histoire.
Alors qu’il était haut-commissaire du Canada à Londres, Mel Cappe a découvert que, dans les jours qui avaient suivi la bataille des plaines d’Abraham en 1759, l’armée britannique avait avisé les citoyens de Québec qu’on respecterait leur langue et leur religion.
Michel Brunet, à qui l'on ne peut reprocher de manquer d’esprit critique — comme l’a souligné Christian Dufour — et qui était l’un des fondateurs de l’école nationaliste de l’histoire du Québec, a écrit que : « … la générosité du Conquérant, sa bienveillance, son souci de l’intérêt général, son esprit de justice lui acquirent le cœur des vaincus4. »
Dans les débats de la Chambre des communes du Parlement britannique sur l’Acte de Québec de 1774, le procureur général sir Edward Thurlow a clairement énoncé les intentions du gouvernement dans les termes suivants :
Vous ne devez changer d’autres lois que celles ayant trait à la souveraineté française, et leur substituer les lois relatives au nouveau souverain… Quant aux autres lois, coutumes et institutions ne touchant pas aux relations entre sujets et souverain, l’humanité, la justice et la sagesse conspirent également pour vous conseiller de laisser les gens tels qu’ils sont5.
Edmund Burke, un homme politique, membre de l’opposition officielle à l’époque, a renchéri en soutenant que si les francophones du Canada héritaient d’une liberté et d’une constitution anglaises, ils feraient une contribution valable et utile à la Grande-Bretagne, peu importe qu’ils parlent français ou anglais, et qu’ils restent catholiques ou non.
C’est en 1842 qu’ont été amorcées conjointement par Robert Baldwin et Louis Hippolyte Lafontaine les premières étapes clés vers une démocratie canadienne.
Comme l’a écrit John Ralston Saul, il s’agissait du premier acte stratégique dans la création du pays : les réformateurs francophones et anglophones avaient soudainement compris qu’ils devaient travailler de concert.
On se souvient de Lord Durham — mais on oublie le fait que, dix ans plus tard, son successeur, Lord Elgin, a lu le discours du trône en anglais et en français, consacrant ainsi le retour du français comme langue officielle du Parlement.
John A. Macdonald l’avait, lui aussi, compris. En 1856, soit une décennie avant la Confédération, il résumait ainsi la tâche du premier ministre :
Il doit se faire l’ami des francophones sans pour autant renier sa race ni sa langue, il doit respecter leur nationalité. Il faut les traiter comme une nation. Ensuite, ils agiront comme un peuple libre le fait généralement, c’est-à-dire avec générosité. Qu’ils soient appelés faction, et ils deviendront factieux6.
L’observation de Macdonald s’est révélée pertinente : ceux d’entre ses successeurs qui ont traité les Canadiens français avec respect ont été reçus avec bienveillance, tandis que ceux qui les considéraient comme une faction ont eu droit à un accueil factieux.
Pour mieux illustrer le sens général de la notion de respect de la part des Canadiens anglais, permettez-moi d’examiner la situation près de cent ans plus tard.
En décembre 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, le premier ministre du Québec, Adélard Godbout, a pris la parole devant le Canadian Club de Toronto.
Dans son allocution publiée dans Le Devoir et louangée à la fois par L’Action nationale et The Globe and Mail, Godbout met en lumière un groupe de Canadiens anglais qui, selon lui, avaient répondu au geste de fraternité des Canadiens français.
Les noms figurant sur sa liste sont à peine connus aujourd’hui. Il s’agissait notamment de William. H. Moore, d’Arthur Hawkes, de Percival F. Morley et de Lorne Pierce.
Qui sont donc ces gens? Pourquoi les avoir singularisés à l’époque? Et pourquoi mentionner leurs noms sept décennies plus tard?
Parce que, selon moi, ces hommes ont jeté les bases d’une identité canadienne qui englobe la dualité linguistique, élément qui a joué un rôle crucial dans la définition du Canada en tant que pays et qui a fait de la tolérance et de l’acceptation des autres l’une de nos valeurs fondamentales.
En 1970, Marcel Trudel et Geneviève Jain, auteurs d’une étude pour la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, recommandaient l’élaboration d’un ouvrage conjoint d’histoire canadienne qui présente non pas une, mais plusieurs interprétations de notre passé.
Cette approche, préconisaient-ils, amènerait les Canadiens anglais et français à épouser ce que les auteurs ont appelé une vision plus objective de l’aventure qu’ils ont partagée et à mieux se comprendre.
Ils ont conclu en affirmant que l’enseignement de l’histoire, jusque-là, avait suivi une tout autre voie. La plupart du temps, cet enseignement n’avait servi qu’à monter un groupe contre l’autre.
Si le Canada est plus que jamais menacé d’une scission, nous pensons que nous devons en chercher la cause dans l’histoire du pays telle qu’elle a été enseignée aux citoyens d’aujourd’hui.
En juin 1991, vingt ans plus tard, le Forum des citoyens sur l’avenir du Canada — la Commission Spicer — a émis une recommandation très semblable pour combler ce que Keith Spicer a appelé « notre manque de connaissance ».
Les provinces hors Québec devraient adopter un programme d’enseignement commun et explorer avec le Québec la possibilité de coordonner davantage la présentation de leurs passés et perspectives très différents.
C’est que le problème restait, et reste encore entier. Les Canadiens ne connaissent pas leur pays et apprennent des versions différentes de son passé. En outre, au niveau universitaire, la discipline de l’histoire a changé, et ces changements se répercutent dans l’enseignement donné par les écoles secondaires.
Il en résulte des manuels d’histoire très différents, des pressions conflictuelles sur les enseignements, pour ne pas dire sur les élèves qui acquièrent des visions très différentes de leur pays.
Les manuels, même s’ils représentent seulement une partie de ce que les élèves apprennent, sont révélateurs. En tant que journaliste il y a deux décennies, je me suis lancé dans une comparaison entre l’enseignement de l’histoire au Québec et en Saskatchewan.
Un ouvrage de la Saskatchewan souligne l’interaction culturelle et l’expérience autochtone; un manuel québécois traite de ce qu’il appelle la société originale du Québec depuis la fondation de la colonie.
Dans un effort pour décrire un passé national, un manuel utilisé en Ontario et dans d’autres provinces relate différentes expériences régionales survenues un peu partout au Canada.
« Les cours d’histoire prennent maintenant toutes sortes de formes très différentes », remarquait Kenneth Osborne, professeur d’éducation à l’Université du Manitoba, qui s’est énormément intéressé à l’évolution des manuels d’histoire.
La chronologie n’est plus le principe organisateur des cours d’histoire qui s’articulent plutôt autour de sujets (en Ontario), de thèmes (au Manitoba) et de questions d’intérêt général (en Alberta). L’histoire locale et régionale reçoit aussi plus d’attention, en particulier dans les études sur les Maritimes enseignées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. L’histoire politique et constitutionnelle n’a pas été abandonnée, poursuit le professeur Osborne, mais les éducateurs ont fait une place aux thèmes sociaux et culturels : l’histoire des femmes, l’histoire des autochtones, l’histoire du mouvement syndical. Même l’histoire quantitative fait maintenant son apparition dans les salles de classe. Le multiculturalisme est devenu un thème incontournable7.
Il résulte de toute cette évolution une sorte d’histoire très différente.
Esther Demers, coauteure parmi d’autres d’un manuel très utilisé au Québec, Le Québec : héritages et projets, indique que l’objectif était d’écrire un ouvrage qui réponde aux critères des programmes d’enseignement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, lesquels prévoient des cours d’histoire du Québec. Il a été impossible de réviser le manuel pour l’utiliser au Nouveau-Brunswick. « Beaucoup d’éléments du manuel les indisposaient, expliquait Mme Demers. Par exemple, ils n’ont pas aimé le fait que le mot Québec soit écrit en caractères aussi gros que le mot Canada sur la carte, toutes sortes de choses qui ne nous avaient jamais traversé l’esprit. »
Le Nouveau-Brunswick a décidé de commander un manuel sur l’histoire du Canada et du Nouveau-Brunswick. Dans les circonstances, il n’est pas surprenant que la façon de voir l’identité canadienne, ou les identités canadiennes, varie autant.
Les Canadiens ont toujours étudié des versions de l’histoire du pays approuvées par 10 ministères de l’Éducation provinciaux différents.
Avec ce projet, comme journaliste, j’ai visité une classe d’histoire dans une école secondaire à Trois-Rivières et une autre à Moose Jaw en Saskatchewan — et j’ai pu faire la même constatation. Les deux manuels d’histoire ne faisaient qu’une petite référence à l’autre société.
Un des seuls exercices de compréhension mutuelle était organisé par l’Institut de recherche en politiques publiques, qui a publié, en 1999, dans les deux langues, un livre intitulé Si je me souviens bien / As I Recall : Regards sur l’histoire.
Ce livre consiste en une série d’essais sur les divergences d’interprétations des évènements de l’histoire canadienne : la conquête, la rébellion des patriotes, le Canada-Uni, la Confédération, la pendaison de Louis Riel, l’édification de l’État providence, la définition de l’identité canadienne, la Révolution tranquille.
L’année suivante, les réseaux anglais et français de la Société Radio-Canada ont diffusé une importante émission d’histoire populaire intitulée Canada: A People’s History / Le Canada : Une histoire populaire.
Dans son livre, le réalisateur Mark Starowicz raconte les difficultés qu’a connues son collaborateur pour le projet, Mario Cardinal :
Pour de nombreux Québécois, le mot Canada est synonyme de frustration, de tromperie, de lutte et d’humiliation. Pour les indépendantistes (c’est-à-dire près de la moitié de la population et la majorité des intellectuels, y compris les journalistes), le mot Canada est tabou. J’ai perdu des amis qui ont cessé de m’adresser la parole simplement parce que j’avais accepté de travailler pour la série8.
Donc, même avoir une conversation commune sur l’histoire est parfois un exercice difficile.
Chaque génération voit son passé d’un œil différent. L’enseignement de l’histoire est donc en évolution constante, tout comme la société. Il n’est pas surprenant de voir l’attention accordée à la question nationale dans les années 70, 80 et 90; après tout, elle dominait alors le débat public.
Quels éléments pourraient susciter une réflexion nouvelle sur le passé? Il en existe plusieurs. Par exemple, la fin de l’implication du Canada en Afghanistan pourrait stimuler une réflexion sur l’histoire militaire et diplomatique. Les tensions dans les rapports canado-américains constituent un autre thème à explorer.
Mais, à mon avis, nous oublions souvent un thème extrêmement important et la transformation démographique du Canada en fait une question d’actualité. C’est l’évolution du Canada comme pays d’accueil des immigrants, la gestion des tensions interculturelles et l’élargissement du sentiment du « nous ».
Dans une société en transformation, il faut que nos professeurs d’histoire comprennent et puissent expliquer les racines de l’inclusion qui font en sorte que le Québec — et le Canada — sont des sociétés d’accueil, qui s’ouvrent aux autres plutôt que de les rejeter ou de les marginaliser.
L’expansion du sentiment du « nous » passe par une compréhension du chemin parcouru par notre société sur la voie de l’inclusion.
Ce défi que doit relever notre société est aussi un défi pour les enseignants de notre histoire.
Mais quel beau défi! Merci.
Thèmes associés à cet article
Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Enjeux de l’univers social de l’Association québécoise pour l’enseignement de l’univers social (AQEUS).