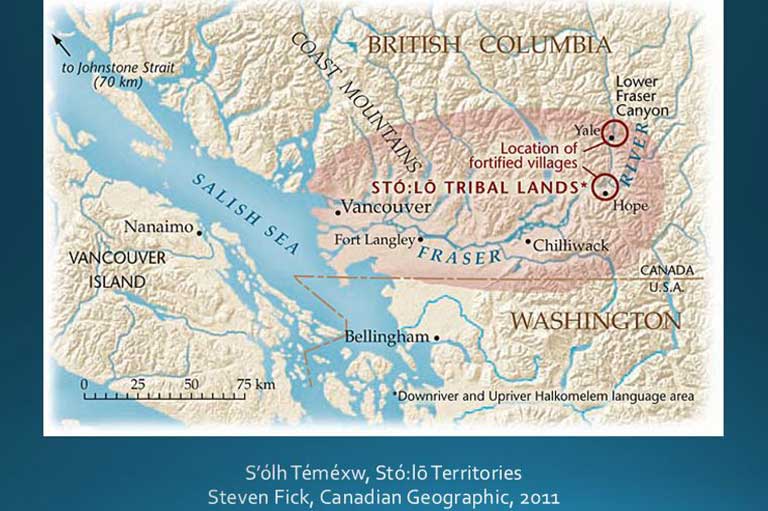Le Gros Bill
Je suis devenu un admirateur de Jean Béliveau les neuf dernières années de sa carrière : j’avais quatorze ans lorsque le légendaire capitaine des Canadiens de Montréal prit sa retraite après avoir gagné dix coupes Stanley.

Mais l’ascendant et l’influence de M. Béliveau sur son équipe, sur son pays et sur la partie de hockey en général se sont fait sentir chaque jour jusqu’à son décès en décembre 2014. Son esprit est toujours bien vivant au sein de l’organisation des Canadiens et l’homme demeure dans une très large mesure la con¬science de l’équipe.
L’admirateur que je suis est devenu journaliste à la fin des années 1970; j’allais côtoyer à maintes reprises ce grand gentleman à l’époque où je gravitais autour des Canadiens. En 1999, alors que son équipe traversait une mauvaise passe, je me suis dit que le fier Jean Béliveau devait souffrir aussi. Vingt‐huit années après avoir marqué le dernier de ses 586 buts, une demi‐douzaine d’années après avoir quitté la vice‐présidence de l’équipe, le Gros Bill, surnom qu’il a hérité dans les années 1950, demeurait le visage que beaucoup de gens associaient à l’équipe la plus prolifique des Canadiens.
Que devait‐il ressentir, alors âgé de soixante‐huit ans, en voyant, soir après soir, de sa place habituelle au centre Molson (renommé depuis Centre Bell), trois rangées derrière le banc des Canadiens, les joueurs courber l’échine après une énième défaite consécutive? Á cette question, il m’a simplement répondu &loquo; Accompagnez-moi &raguo;. Je l’ai donc accompagné le 11 novembre 1999 et j’ai vécu la soirée la plus mémorable de ma vie professionnelle.
Assis à côté de cette icône du hockey et ce héros de ma jeunesse, j’ai pu constater que M. Béliveau, dans sa veste finement taillée, était aussi élégant et de présence imposante qu’il l’avait été vêtu du chandail bleu, blanc et rouge. À l’endroit sur le chandail où le C de capitaine a été visible de 1961 à 1971, il portait le coquelicot du jour du Souvenir et son épinglette de l’Ordre du Canada.
Élise, son épouse depuis quarante&dahs;six années, et Magalie Roy, alors âgée de treize ans, une de ses deux petites‐filles, étaient avec lui. On peut voir depuis les sièges de l’amphithéâtre le chandail arborant le numéro 4 de M. Béliveau pendre du plafond parmi les bannières des vingt‐quatre coupes Stanley remportées par les Canadiens.
Béliveau a véhiculé le souvenir à la fois réjouissant et douloureux des jours où pour les Montréalais, le Graal d’argent de Lord Stanley était plus qu’un mirage.
Vingt‐quatre heures auparavant à Pittsburgh, les Canadiens avaient plié bagage plus rapidement que des scouts en laissant filer, dans les dix dernières minutes de la partie, une avance de trois buts, concédant ainsi aux Penguins la victoire de 5 à 4. Ils affrontaient maintenant les Mighty Ducks d’Anaheim, invaincus à leurs neuf dernières parties.
« Ils souffrent probablement plus sur le plan émotif que physique », dit M. Béliveau. « Regardez Alain. Il est gris. » Ce n’était pas des cheveux de l’entraîneur Alain Vigneault dont il parlait, plutôt de son teint.
L’atmosphère derrière le banc était lourde et glaciale. M. Béliveau échappa un petit rire en entendant l’entraîneur Vigneault enguirlander, avec force d’invectives populaires dans les deux langues officielles du Canada, un juge de ligne francophone qui avait omis de signaler un déblaiement. « On a une meilleure vue de la patinoire quelques rangées plus haut », ajouta M. Béliveau. « Imaginez lorsque j’invite un père, qui autrement n’en aurait pas les moyens, et son fils et que le garçon puisse voir et entendre de si près les joueurs. Il se croît dans un rêve. »
M. Béliveau regardait l’affrontement à la fois comme partisan et spécialiste, étudiant la façon dont un jeu s’amorçait à un bout de la patinoire et prédisant avec une exactitude troublante son dénouement à l’autre bout quinze secondes plus tard. Si un chasseur d’autographes se présentait – et il y en avait beaucoup – il lui demandait poliment de revenir à la fin de la période, pour ne pas bloquer la vue au spectateur derrière.
Nous avons tous vu l’entraîneur Vigneault faire les cent pas, montrer des signes d’impatience et – enfin – applaudir au score final de 2 à 1 en faveur des Canadiens.
Au son de la sirène finale, M. Béliveau s’est levé et a applaudi pour célébrer la fin de la longue glissade de l’équipe. Vigneault, dont les joues avaient retrouvé leur couleur, soupirait de soulagement.
« Il y a de grands amateurs de hockey dans cette ville », dit M. Béliveau alors que nous retraitions vers le salon des anciens de l’équipe.
« Mais ne croyez-vous pas », poursuivit‐il, sourire en coin, « que nous les avons gâtés avec toutes ces coupes Stanley? »
En lire davantage:
Pour qui résonne le métal : les malheureux Canucks voient leurs rêves de coupe anéantis.
Thèmes associés à cet article
Publicité