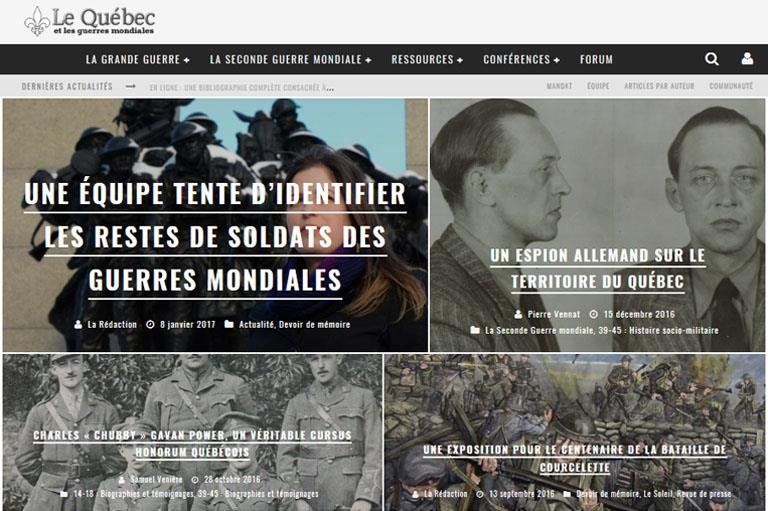Derrière les lignes ennemies

Le 6 juin marque l’anniversaire des débarquements du jour J en Normandie, une opération qui a mené à la libération de l’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Afin de préparer le terrain en vue de cette invasion, les Alliés ont procédé à de nombreux bombardements pour pratiquer une brèche dans la résistance. Le travail était risqué et les avions alliés étaient souvent abattus en plein vol; les pilotes étaient alors fait prisonniers ou mourraient de leurs blessures. Mais certains réussirent à s’échapper.
Un groupe d’élite composé de Canadiens-français, posté derrière les lignes ennemies en France, avait la tâche difficile de rescaper ces aviateurs pour les renvoyer en Grande-Bretagne.
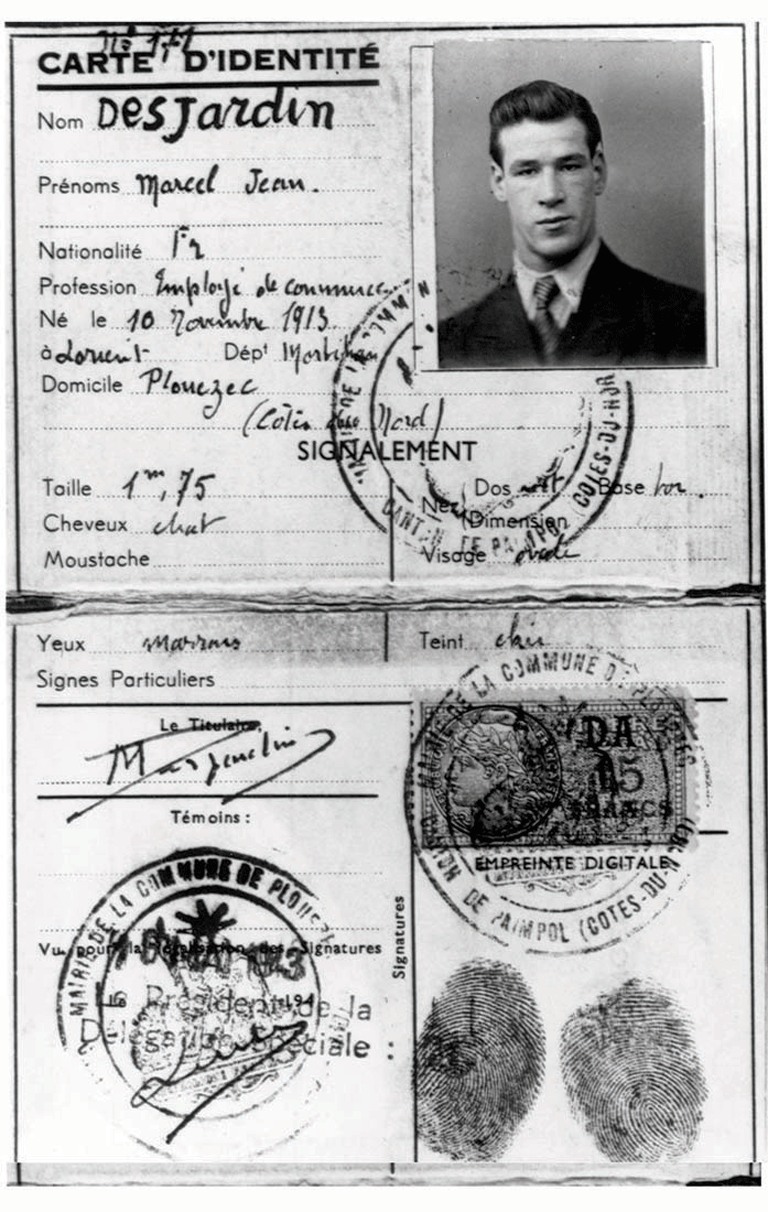
Craignant le pire, Lucien Dumais ralentit son vélo. Dans l’allée bombardée qui se dressait devant lui se tenait un sergent de l’armée allemande, fusil en bandoulière, lui intimant de s’arrêter. Nous sommes vers la fin de l’automne 1943. Dumais et son compagnon de voyage, Raymond LaBrosse, venaient de quitter la ville française de Rennes, en Bretagne, et étaient en route pour s’acquitter d’une tâche dangereuse. Cet imprévu risquait de compromettre leur mission, mettant en danger la vie de nombreuses personnes, incluant nos deux protagonistes.
Alors que LaBrosse se rapproche de lui, Dumais lui fait part de son idée.
« Nous sommes faits comme des rats s’il trouve la radio, chuchote Dumais, soldat trapu et de petite taille. Poursuis ton chemin et moi je m’occupe de voir ce qu’il veut. »
LaBrosse, plus grand, plus costaud et de vingt ans son cadet, poursuit sa route alors que Dumais s’arrête devant l’Allemand, parlant à toute allure pour tenter de distraire le sergent. Dumais avait de bonnes raisons d’être inquiet. Si l’Allemand trouve la radio sans fil cachée dans la valise fixée au vélo de LaBrosse, les deux cyclistes seront tués sur le champ ou emmenés aux quartiers les plus proches de la Gestapo, où ils seront torturés et exécutés, sans l’ombre d’un doute.
Et pour rendre la situation encore plus périlleuse, ajoutons que Dumais et LaBrosse mentaient sur leur identité, se faisant passer pour deux citoyens français en route vers la petite ville côtière de Plouha afin de chercher du travail. Selon leurs papiers, Dumais se prénomme Jean-Francois Guillou, travailleur des pompes funèbres, et LaBrosse, Marcel Desjardins, vendeur d’équipement médical.
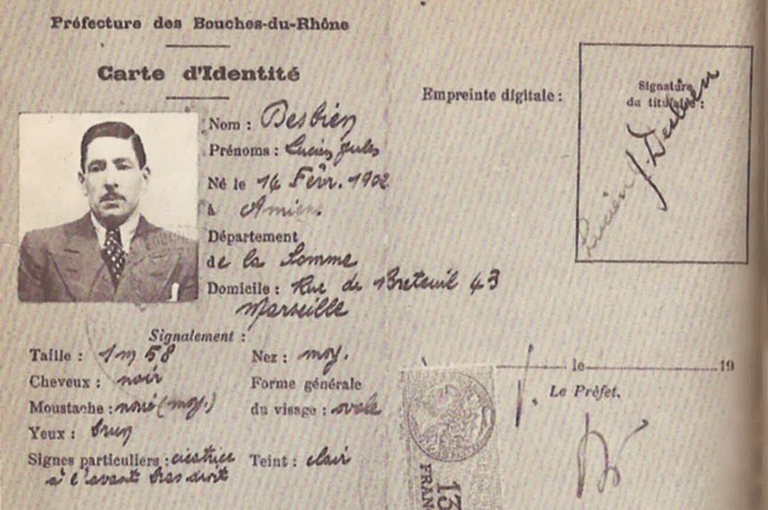
Dans les faits, ces hommes sont deux soldats canadiens-français habillés en civil opérant secrètement en France, alors occupée par les Nazis. Les francophones — Dumais était de Montréal, LaBrosse d’Ottawa — étaient des espions relevant directement de l’agence d’espionnage britannique. Leur tâche consistait à travailler avec la Résistance pour faire sortir de France les pilotes alliés.
Alors qu’il s’éloigne en pédalant — laissant Dumais seul avec l’Allemand — LaBrosse est déchiré entre son désir naturel de faire demi-tour pour aider son camarade et son sens du devoir. Mais il décide de poursuivre sa route vers la côte bretonne, comme on le lui a ordonné, même s’il est presque convaincu que ses efforts sont vains.
La mission de nos deux protagonistes consiste à monter un réseau d’évasion, sous le nom de code Opération Bonaparte, en France occupée. L’interception de Dumais compromet gravement la mission. Heureusement, LaBrosse connaît le plan par cœur.
LaBrosse pédale jusqu’à la nuit tombée. Il dort à la belle étoile et se réveille à l’aurore, déterminé à atteindre sa destination plus tard dans la journée. Alors qu’il se rapproche de Saint-Brieuc, une ville près de Plouha, il commence à ressentir la fatigue et la soif. Il décide de faire une pause dans un café, où il aperçoit un homme attablé devant deux verres de cognac. LaBrosse tombe pratiquement de son vélo lorsqu’il réalise que cet homme n’est nul autre que Lucien Dumais! Mais cela lui paraît tout à fait improbable.
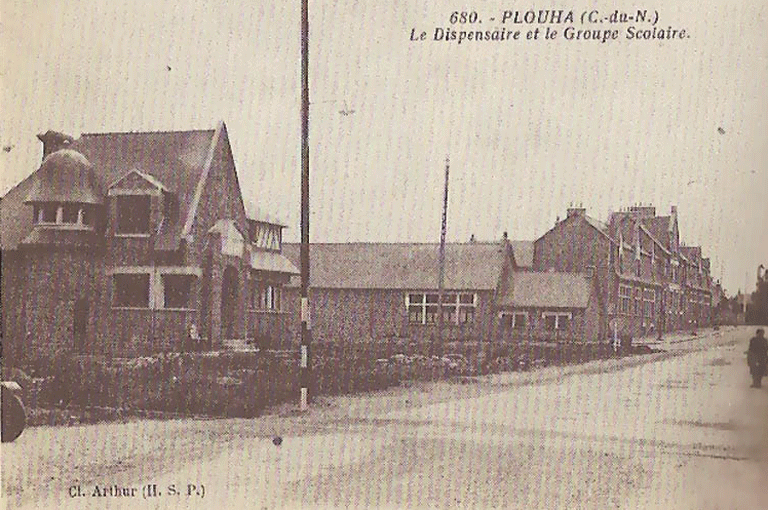
« Tu en as mis du temps! » s’exclame Dumais avec un large sourire, alors que LaBrosse, encore sous le choc, s’affale dans sa chaise, tend la main vers le deuxième cognac et l’avale d’une seule traite.
« Tout ce que l’Allemand voulait, c’était le vélo », poursuit Dumais, qui ajoute qu’il a ensuite fait ce que tout bon Français aurait fait. Il s’est rendu au poste allemand le plus près et exigé qu’on l’accompagne jusqu’à la côte, puisqu’on lui avait confisqué son vélo. Pour faire bonne mesure, il laisse également entendre qu’il a des contacts avec la redoutable Gestapo.
Le véhicule de l’armée allemande transportant Dumais à Saint-Brieuc avait passé tout juste à côté de l’endroit où LaBrosse s’était installé pour la nuit.
Dumais et LaBrosse étaient les piliers de l’Opération Bonaparte, le segment breton d’un vaste réseau d’évasion allié appelé le réseau Shelburne. Comme les Alliés prévoyaient envahir la Normandie en juin 1944, un nombre croissant d’avions alliés procédaient à des bombardements massifs contre des cibles stratégiques en France afin d’affaiblir l’ennemi. Mais ces vols plus nombreux entraînaient nécessairement un plus grand nombre de pilotes survivants à évacuer.
Le réseau avait été monté par l’agence d’espionnage britannique alors appelée M.I.9. Dumais et LaBrosse furent sélectionnés comme agents responsables de l’Opération Bonaparte non seulement parce qu’ils étaient bilingues, mais parce qu’ils avaient déjà réussi à s’échapper de France pour revenir en Angleterre.
LaBrosse s’enrôle dans le service actif de l’armée canadienne en 1940, dès ses 18 ans. Il était sergent dans le Corps des transmissions royal du Canada lorsque les Britanniques le recrutent comme leur premier espion canadien.
Il est parachuté en France le 28 février 1943, où il servira de point de contact entre une cellule de la Résistance française à Paris et le service secret britannique. Il s’emploie rapidement à faire sauter des ponts et des installations ferroviaires, et manie la mitraillette et autres petites armes lors de raids contre les Allemands.
La police secrète allemande parvient cependant à infiltrer la cellule de résistants. Apprenant cela, le M.I.9 ordonne à LaBrosse de quitter la France pour éviter d’être arrêté. LaBrosse répond par radio qu’il doit s’occuper de 29 pilotes alliés dont l’avion a été abattu, et qui pour la plupart ne parlent pas un mot de français. Le message suivant du M.I.9 ordonne à LaBrosse d’abandonner les pilotes. Il refuse net et guide plutôt les pilotes sur le territoire ennemi, leur fait traverser les Pyrénées jusqu’en Espagne, pour atteindre enfin le territoire britannique de Gibraltar sur la Méditerranée.
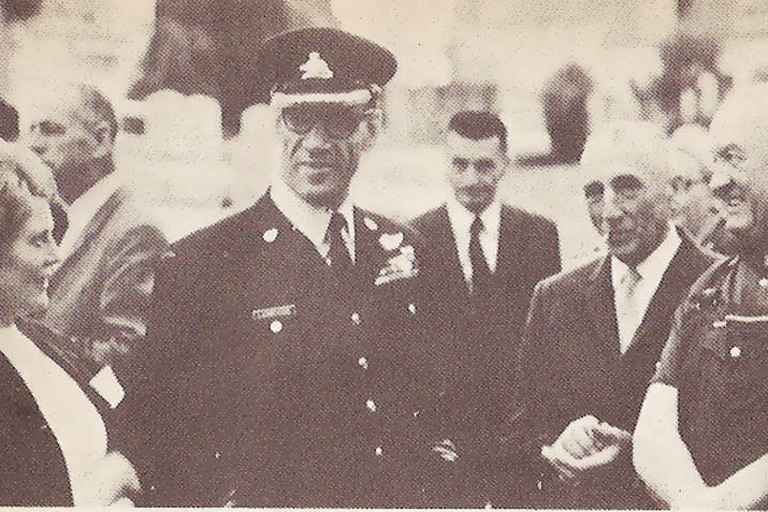
Dumais est un sergent‑major de carrière âgé de 38 ans avec les Fusiliers Mont-Royal lorsqu’il est capturé, avec deux mille autres soldats canadiens, lors d’un raid suicidaire dans le port de Dieppe, en août 1942. Jurant qu’il ne serait jamais livré vivant aux Allemands, il s’échappe du train qui le mène en Allemagne. Comme LaBrosse, il prend la fuite en passant par les Pyrénées.
LaBrosse et Dumais se rencontrent en Angleterre, où ils suivent ensemble une formation d’espion. Le jeune et doux LaBrosse, et son acolyte Dumais, un dur à cuire à l’orée de la quarantaine, se révèlent former une excellente équipe, malgré les doutes émis par Dumais. Ce dernier craint que LaBrosse ne soit pas de taille devant les rugueux combattants de la Résistance français auxquels il serait confronté.
Mais peu après leur atterrissage sur une piste improvisée hors de Paris, le 19 novembre 1943, LaBrosse fait ses preuves alors que les résistants viennent leur donner un coup de main.
« Tout le monde se dépêchait d’emporter l’équipement pour quitter rapidement le lieu de rendez-vous », évoque Dumais lors d’un retour à Plouha, en 1948, pour une cérémonie du gouvernement français organisée en l’honneur des membres de l’Opération Bonaparte.
« La valise de Raymond contenant la radio sans fil était entre ses pieds. Alors qu’un Français tente de s’en emparer, Raymond lui siffle : "Laissez-ça tranquille". Les deux hommes se fixent droit dans les yeux dans une ambiance tendue. Le résistant esquisse alors un sourire, hausse les épaules et lui abandonne la valise, comme Raymond le lui a ordonné. La crise est désamorcée.
Ils arrivaient fort bien à se faire passer pour des Français. Les soldats allemands qu’ils croisaient pensaient que leur accent québécois était le dialecte d’un village français éloigné. « Par contre, expliquera plus tard LaBrosse, il ne fallait pas employer d’expressions idiomatiques ou typiques des Canadiens-français. Si l’on parlait bien français, personne ne pouvait savoir qu’on était Canadiens, malgré notre accent ».
Dès leur arrivée en France, ils se mettent au travail, en traçant des routes d’évasion, sélectionnant des cachettes et préparant la livraison de fournitures et d’armes. Ils recrutent des douzaines de civils français pour faire passer les pilotes fugitifs à Plouha, un petit village côtier où se terre une solide cellule de résistants. Les pilotes y sont cachés jusqu’à ce qu’ils puissent être évacués par la plage, à proximité.
Les quelques semaines suivantes filent à toute allure et les deux hommes sont bientôt prêts à lancer l’Opération Bonaparte. Enfin, la nuit du 29 janvier 1944, Dumais et LaBrosse écoutent la radio à faible volume dans une petite maison de ferme en pierre à Plouha lorsqu’ils entendent : « Bonjour tout le monde à la maison d’Alphonse! »

En souhaitant la bienvenue à tous les habitants de la maison d’Alphonse, l’annonceur du service français de la BBC lance un appel à l’action. Une canonnière à moteur de la marine royale vient de quitter Dartmouth, en Angleterre, et traverse à vive allure les 140 kilomètres la séparant de la côte bretonne. C’est le coup d’envoi. Les agents ferment immédiatement la radio. « Ça y est », s’exclame LaBrosse. Dumais se tourne vers le troisième occupant de la pièce, le chef de section François LeCornec, et de la tête lui indique : « Allons-y ».
La région de Plouha est infestée de soldats allemands, d’agents de la Gestapo et de collaborateurs français. On savait que les alliés préparaient une invasion massive en France. Les Allemands, tendus et à cran, risquent fort de tirer en premier et de poser des questions ensuite.
Alors qu’ils quittent la maison d’Alphonse, bien mal nommée d’ailleurs puisqu’elle appartient à un résistant français nommé Jean Gicquel, Dumais et LaBrosse distinguent plusieurs silhouettes qui s’agitent dans la pénombre près des autres maisons. Le groupe à évacuer est formé de 16 pilotes américains et de la RAF et de deux agents britanniques. LaBrosse avait envoyé un message au M.I.9 plus tôt dans la journée indiquant qu’il avait 18 « colis » à ramasser.
Dumais chuchote aux 18 « colis » ses instructions de dernière minute pour descendre la pente escarpée qui mène à la plage. Il les avertit que la pente a été minée par les Allemands, mais qu’un résistant a identifié chaque mine par un petit drapeau blanc. Dumais montrera la voie en passant devant avec une lampe de poche dont le faisceau est voilé, et tout le monde devra marcher dans ses pas jusqu’à la plage, environ 75 mètres plus bas.

« De nombreuses vies ont été risquées pour vous emmener jusqu’ici, explique Dumais. Il ne reste qu’un kilomètre à parcourir et ce sera sans doute le kilomètre de tous les dangers. Vous devez rester absolument silencieux et faire exactement ce qu’on vous dit. Il y a des sentinelles et des patrouilles ennemies dans le coin. S’il faut tuer des soldats ennemis, nous aurons besoin de votre aide : utilisez vos mains ou vos couteaux. Soyez rapides et surtout silencieux. Vos vies et les nôtres en dépendent. »
Avec LaBrosse fermant la marche, les hommes descendent silencieusement la pente menant à la plage. Frissonnant dans l’air glacial et humide, ils ont les yeux et les oreilles aux aguets pour suivre chaque signe de leurs sauveteurs. Les minutes s’étirent. Soudainement, dans l’obscurité, les silhouettes de quatre petites embarcations apparaissent, chacune conduite par deux hommes. Les embarcations accostent sur la plage et les huit membres d’équipage de la canonnière, ancrée à huit kilomètres au large, mettent pied à terre.
Un officier lance sèchement : « Vite, embarquez ». En même temps, l’équipage commence à décharger des armes, de l’argent et les fournitures dont a grandement besoin la résistance française.
Après quelques minutes, les quatre embarcations repartent, disparaissant dans la nuit. Dumais et LaBrosse les regardent s’éloigner, s’emparent du matériel et remontent la pente avec prudence jusqu’à la maison de pierres, tout en récupérant les petits drapeaux blancs indiquant l’emplacement des mines allemandes.

En attendant la levée du couvre-feu allemand, à 6 h, Dumais lève son verre de vin : « En bien. À notre premier succès. Tout s’est bien passé, mais nous ne chômerons pas dans les semaines qui viennent ». Jusqu’au débarquement des Alliés en Normandie, lors de l’offensive du jour J le 6 juin 1944, l’Opération Bonaparte réussit, en l’espace de six mois, à sauver 135 fugitifs alliés sous le nez des agents de la Gestapo sans perdre un seul homme. Dumais et LaBrosse ont certainement fait leurs preuves.
« Nous avons eu raison de faire confiance à ces deux hommes et ils ont agi de façon exceptionnelle », affirmera Airey Neave, organisateur en chef du M.I.9 pendant les deux dernières années de la Seconde Guerre mondiale, dans son ouvrage Saturday at M.I.9.
Après le jour J, Dumais et LaBrosse travailleront dans la clandestinité aux côtés des Français pour combattre les Allemands en retraite. Après la reddition des Nazis en mai 1945, Dumais est choisi pour débusquer les collaborateurs qui se terrent toujours. Il se retire avec le rang de capitaine, à la fin de la guerre, et porte avec fierté plusieurs décorations, dont la Croix militaire, la Médaille militaire, la Médaille d’efficacité et la Médaille de la liberté.
LaBrosse rejoint l’armée canadienne après la guerre, et servira plus tard au sein du troisième bataillon du Royal 22e Régiment, les Van Doos, en Corée. Il prend sa retraite avec le rang de lieutenant-colonel en 1971. Il recevra notamment la Croix militaire, la Légion d’honneur, la Croix de Guerre française (avec palme et étoile de vermeil), et la U.S. Medal of Liberty avec une barre d’argent.
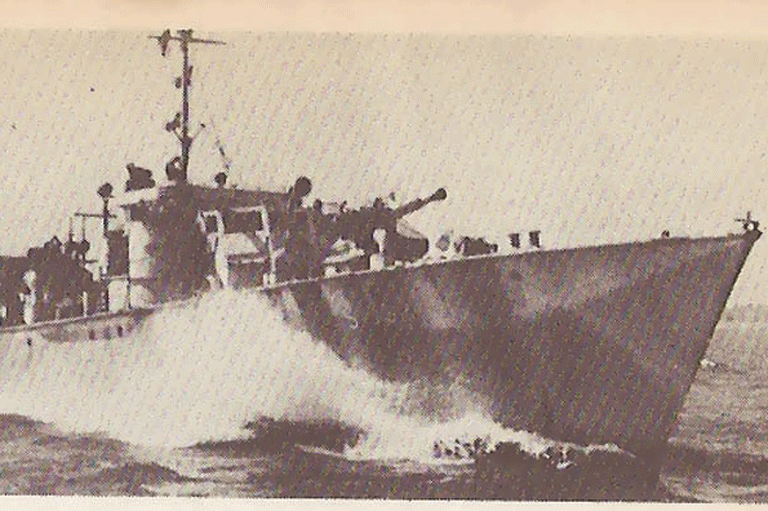
Malheureusement, l’équipage de la canonnière à moteur, le MGB 503, utilisé pour évacuer les pilotes, ne connaîtra pas un sort aussi heureux que les deux espions canadiens. L’embarcation frappera une mine flottante dans la Manche, peu après la fin des hostilités, tuant du coup les 36 membres de l’équipage.
La maison d’Alphonse fait également partie des victimes de la guerre. Après le démantèlement de l’Opération Bonaparte, les Allemands commencèrent à soupçonner, avec un peu de retard, que la petite maison servait de cache pour les Résistants et incendia les lieux, ne laissant que les murs de pierre noircis pour témoigner de ces opérations clandestines.

L’Opération Bonaparte reçoit très peu de publicité pendant et après la Seconde Guerre mondiale, en raison de sa nature délicate. En fait, lorsque l’on ordonna de remettre les dossiers aux archives publiques de Grande-Bretagne, on découvrit que plusieurs volumes de documents sur le projet avaient disparu.
Mais certains des 94 pilotes américains rescapés de la France occupée ont tenu à montrer leur reconnaissance en tenant une cérémonie spéciale à Buffalo, New York, en 1964. En présence de LaBrosse et Dumais, et de deux anciens membres de la Résistance, William Spinning, vice-président de la toute nouvelle Air Forces Escape & Evasion Society affirme : « Ils ont posé des gestes d’une audace et d’un courage inédits, sous les yeux mêmes des forces d’occupation allemande. L’échec de ces opérations nous paraissait presque inévitable et les conséquences de cet échec, incalculables. Nous, Américains, ne pourrons jamais signifier notre véritable reconnaissance envers ces nobles personnages. Rien ne nous permettra jamais de leur rendre la pareille et rien ne viendra ternir leur gloire ».
« En toute humilité, nous leur disons : Nous n’oublierons jamais! »

Deux espions qui ne feront pas le voyage de retour
Frank Pickersgill: Frère du ministre du cabinet fédéral de longue date, Jack Pickersgill, Frank sera arrêté par la Gestapo après avoir été parachuté en France occupée, la nuit du 15 juin 1943. Il subira la torture et sera ensuite emmené aux quartiers généraux de la Gestapo à Paris, où on lui promet qu’il sera bien traité jusqu’à la fin de la guerre s’il coopère et trahit ses camarades espions.
Furieux, Pickersgill attrape une bouteille d’eau de Vichy sur le bureau de son interrogateur, la fracasse sur la tête d’un garde allemand et se sert des tessons pour couper la gorge du deuxième soldat présent. Il saute de la fenêtre du deuxième étage sous les coups de feu ennemis. Il survit, mais sera immédiatement repris. Quelques mois plus tard, il sera exécuté à Buchenwald par strangulation lente – il est pendu à un mur avec une corde de piano attachée à un crochet à viande.
Guy Bieler: Bieler, un Suisse qui émigre au Canada dans les années 1920, se blesse grièvement au dos lors d’un saut en parachute en France, le 8 novembre 1942. Il parvient à diriger des raids contre des installations allemandes à partir d’une cache en forêt, même s’il souffre le martyre et est à peine mobile.
La plupart des espions alliés étaient menottés, abattus d’une balle derrière la tête ou lentement étranglés avec une corde de piano. La mort par peloton d’exécution était considérée comme un honneur, honneur qui lui fut accordé par un commandant du camp qui respectait le courage et le calme de Bieler tout au long de ces terribles mois de torture et de privations.
Et un qui reviendra
Gabriel Chartrand: Appelé Gaby par ses amis, il est le troisième Canadien parachuté en France en 1943. Il sera arrêté alors qu’il retourne à Tours en vélo, après avoir participé à l’évasion d’un pilote américain.
Chartrand comprend vite qu’il doit se sauver avant d’être emmené au centre d’interrogation de la Gestapo. Contre toute attente, il lance son vélo à l’officier allemand qui l’arrête et prend la fuite en courant. Zigzaguant pour éviter les tirs, Chartrand parvient à retrouver son petit appartement et se munit de faux papier d’identité qu’il avait récupéré plus tôt.
Il entre en contact avec un camarade, qui l’envoie à Plouha, en Bretagne, où deux espions canadiens pourront l’aider à s’échapper par la Manche. Ces deux espions, comme il l’apprendra après la guerre, ne sont nuls autres que Lucien Dumais et Raymond LaBrosse.
Thèmes associés à cet article
Publicité